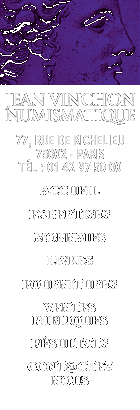
![]()
Voir la carte
Eblouissantes par la richesse de leur matière, troublantes par le mystère de leurs origines, passionnantes par l’intérêt de leurs motifs, les monnaies offrent un magnifique panorama de l’Histoire. Elles nous permettent de revivre la grande Epopée de l’humanité, grâce à leur témoignage dont l’authenticité ne saurait être mis en cause.
Dans ce catalogue, se trouvent réunis près de quatre vingt documents monétaires en or, en électrum, en argent et en bronze provenant des monnayages de l’antiquité - de la Grèce, de Rome, de la Gaule et du royaume des Francs. Le collectionneur s’est attaché à rassembler des spécimens d’une incroyable beauté.
La dispersion débute par l’époque gauloise marquée par un statère d’or des Parisii de la classe V inspirée des monnaies de la Grèce antique.
Le monnayage grec occupe une place privilégiée en raison de son double intérêt sur les plans historique et artistique. On peut classer les monnaies grecques en trois périodes : la période archaïque ou de formation qui s’étend de 700 avant J.-C. jusqu’aux guerres médiques en 480 avant J.-C. ; la période d’efflorescence, de 480 à la mort d’Alexandre en 323 et l’époque hellénistique qui couvre les trois derniers siècles avant notre ère.
La coutume veut que le classement du numéraire grec se fasse géographiquement : la Grande Grèce avec l’Italie et la Sicile à laquelle on rattache Carthage ; la Grèce proprement dite divisée en régions, la Macédoine, la Thrace, Athènes et sa région, le Péloponnèse puis les Cyclades ; l’Asie Mineure et enfin l’Afrique.
En occident, les grecs inventèrent la monnaie dès le VIe siècle avant notre ère. Les grandes civilisations qui avaient existé jusqu’alors, bien qu’elles aient eu une activité commerciale développée, n’avaient pas connu de systèmes monétaires.
Allyate (610-561), roi de Lydie, en Asie Mineure, fit frapper une tête de lion sur des pépites d’électrum, un alliage naturel d’or et d’argent. Crésus (561-546) fut le premier des Mermnades à utiliser l’étalon d’or pur en émettant les créséides ornées du “couple oriental”, c’est-à-dire du lion et du taureau affrontés. Leur gravure d’une élégante simplicité descend en droite ligne des peintures néolithiques telles qu’on peut les voir à Lascaux.
Parmi les monnaies les plus archaïques de cet ensemble on notera le monnayage de Cyzique représenté par de superbes statères et hectés en électrum, métal fourni par les régions du Caucase et de l’Oural. A titre d’exemple, un statère de Cyzique constituait la solde mensuelle d’un hoplite grec. Son poids d’environ 16 g représentait l’équivalent d’une darique d’or pur.
Après avoir subi la domination des rois de Lydie, Cyzique fut sujette des rois de Perse, jusqu’à la défaite de Xerxès. En 478, elle passa sous l’hégémonie athénienne et, à partir de cette époque, devenue station navale des athéniens la plus importante, elle redouble d’activité dans l’émission de belles séries de monnaies d’électrum, dont les plus anciennes remontent au commencement du VIe siècle. On sait que Cyzique emprunta un peu partout aux autres villes grecques leurs types monétaires pour se les approprier - non toutefois sans ajouter un petit thon en exergue symbolisant son activité intense de centre de pêche. Le revers en forme de carré creux, dont les compartiments à surface granuleuse disposés en ailes de moulin permettait de refouler la matière dans la gravure du coin de l’avers encastré dans l’enclume.
Situées en Ionie et en éolide, les Îes de Phocée et de Lesbos et Mytilène émettent dès le début du Ve siècle des petites pièces d’électrum appelées “hectés”. Ces minuscules monnaies de types variés étaient si petites que, dit-on, “les gens les mettaient dans la bouche pour ne pas les perdre”. Un bœuf est représenté sur le revers de l’une d’entre elles. L’expression “avoir un bœuf sur la langue” vient de là.
Les seules villes de la Grande Grèce qui aient frappé des monnaies dans la période primitive c’est-à-dire antérieurement à 480 avant J.-C. sont Tarente, Métaponte, Sybaris, Crotone, Caulonia, Posidonia, et quelques autres cités.
Ce monnayage, dont le point commun est le revers orné du motif en creux représenté à l’avers, débute à l’époque de la venue de Pythagore en Italie vers 550 et se compose de statères d’argent de flan large et de poids similaires. L’originalité de ce procédé n’eut qu’une existence éphémère et ne fut imité nulle part ailleurs.
S’il exista, dans l’antiquité, une région bénie des dieux où l’art du monnayage atteignit la perfection, ce fut bien la Sicile avec sa capitale artistique, Syracuse.
Les premières émissions monétaires font leur apparition à la fin du VIe siècle avant notre ère et la plupart étaient en argent. Peut-être les Syracusains disposaient-ils d’une très grande quantité de ce métal? Les plus anciennes monnaies de Syracuse inaugurent un type qui devait se perpétuer pendant près de trois siècles par d’ingénieuses variétés de la tête d’Aréthuse, nymphe chasseresse de l’Elide métamorphosée en fontaine.
L’art monétaire ne prit son plein essor qu’à l’époque classique grâce au talent et à l’habileté des graveurs Kimon et Evainète, qui exécutèrent les coins des décadrachmes. De toutes les monnaies de l’antiquité, ce sont ces fameux décadrachmes qui ont provoqué l’admiration la plus universelle, tant autrefois que de nos jours. Ces pièces pesantes dont il ne subsiste que peu d’exemplaires, étaient vraisemblablement décernées aux vainqueurs des jeux athlétiques dits de l’Assinaros, organisés pour célébrer la victoire remportée sur les Athéniens en 413. Au revers de ces monnaies, sont évoquées les armes prises par les Syracusains lors des combats.
A leur suite prend place le numéraire siculo-punique émis entre la défaite et la mort d’Annibal, célèbre général carthaginois 183. Ces superbes monnaies au profil de Perséphone inspiré des décadrachmes d’Evainète sortent du principal atelier monétaire carthaginois : le port de Lilybaion, l’actuelle Marsala.
Parmi les monnaies émises par les villes macédoniennes, on remarquera la belle composition d’un tétradrachme d’Acanthe.
Colonie grecque du continent chalcidien, Acanthe avait un type presque constant du groupe du lion dévorant un taureau - ce qui ne surprendra pas si l’on se rappelle Hérodote racontant que les lions et les bœufs sauvages étaient abondants dans cette région.
Cette monnaie nous fait connaître, avec un réalisme saisissant, les luttes quotidiennes entre lions et taureaux : la souplesse, la vigueur et la puissante musculature de ces animaux sont traduites avec une grande virtuosité. En effet, l’affrontement s’inscrit parfaitement dans le champ de la monnaie d’une manière harmonieuse tout en conservant proportion et équilibre.
A Pnytagoras, roi de Salamine (351-332), adversaire heureux d’Evagoras II (roi de Sidon 349-346), nous devons un remarquable et rare statère d’or représentant la déesse chypriote Aphrodite dont les richissimes coiffures rappellent certains types originaux des statues et des terres cuites de l’Île de Chypre.
Les lourdes monnaies d’or de la période ptolémaïque qui clôturent la série grecque de cette collection forment une sorte de somptueuse parure de rois grecs d’Egypte.
C’est Ptolémée Ier Soter “le Sauveur” qui fonde la dynastie grecque des Lagides. En 306, il prend le titre de roi. Avant de mourir, il associe à la couronne son fils Ptolémée II Philadelphe qu’il avait eu de sa quatrième épouse Bérénice Ière. Ptolémée II épouse Arsinoé II, sa sœur, qu’il fit diviniser à sa mort en 270. Ces quatre personnages sont représentés sur un seul et même octodrachme d’or. Le bouclier qui figure derrière les têtes de Ptolémée et Arsinoé est gaulois et rappelle l’embauchage des mercenaires galates après l’invasion celtique en Grèce en 280 et leur extermination en 277.
On remarquera également le splendide portrait de la reine Bérénice II épouse de Ptolémée IV Philopator dont l’attitude altière évoque la situation qu’elle occupait dans les affaires intérieures et extérieures de ce pays. On dit que les monnaies de la reine Bérénice auraient été frappées lors de la campagne de Ptolémée Evergète en Asie, avec le butin remporté par Chrémonidès sur le satrape Aribazos - Bérénice était alors régente. On dit encore qu’elles auraient été émises dans les villes côtières d’Asie Mineure selon l’étalon Séleucides par Bérénice Syra, après la mort de Ptolémée Evergète en 248.
Devenu sous l’empire romain un instrument de propagande et d’information, la monnaie présentait généralement le portrait de l’empereur, traité dans un style réaliste, et parfois celui de certains membres de sa famille.
Une riche iconographie nous révèle, avec une grande fidélité, les traits de plusieurs empereurs qui permettent de suivre en quelques exemplaires les fastes et la décadence de cette civilisation.
Parmi ce beau monnayage, deux médaillons de bronze se détachent en raison de leur grande rareté, leur haute qualité et leur intérêt sur le plan historique. L’un est de Probus (276-282) et l’autre de Galère Maximien (305-311).
En ces temps, la valeur de la monnaie ne cesse de s’altérer pour une loi qui semble inéluctable. Sous Valérien et sous Gallien la banqueroute est un fait accompli et les particuliers sont ruinés. Ils n’ont entre les mains que du billon dont la valeur est purement fictive. On appelle médaillon un exemplaire dont les dimensions dépassent celles de la monnaie ordinaire. Ces médaillons aux “Trois Monnaies” dont le revers représente les trois métaux personnifiés (l’or, l’argent, le bronze) ont été émis au moment des grandes réformes monétaires pour attester du maintien des règlements sur le poids, l’alliage du numéraire et la quantité même des émissions mais surtout pour rassurer la population.
La dernière monnaie de cette vacation mérite une place à part. Il s’agit d’une monnaie franque en or frappée du temps de Clovis avant sa conversion au christianisme qui suivit sa victoire sur les Alamans en 496 et son couronnement en tant que roi des Francs le jour de Noël 497.
C’est avec Clovis (481-511), le véritable fondateur de la monarchie, qu’apparaissent les signes particuliers qui révèlent une fabrication propre aux barbares.
Cette monnaie est la réplique d’un sou d’or de l’empereur Anastase puisque Clovis n’avait pas voulu réformer le monnayage byzantin auquel son peuple était habitué. Il considérait le droit régalien comme une institution impériale. Il semblerait que les deux lettres C situées en début et en fin de légende soient la marque distinctive de la monnaie chlodovéenne. Ces marques auraient été conservées par les trois fils de Clovis : Clodomir, Childebert Ier et Clothaire Ier, aux noms desquels ils pouvaient également convenir.
Parvenues jusqu’à nous dans leur éternelle fraîcheur, les monnaies ne sont jamais muettes et comme le dit La Bruyère, “elles sont les preuves parlantes de certains faits, de monuments fixes et indubitables de l’ancienne histoire”.
Au delà des interrogations de notre époque, les monnaies nous font découvrir les énigmes du passé.
Françoise BERTHELOT-Vinchon