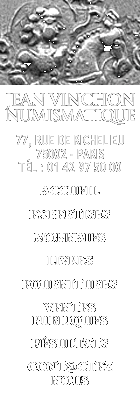![]()
La Numismatique n'a plus besoin d'apologie ; il faut
attribuer sa grande et constante faveur à ce qu'elle donne de satisfaction
à deux aspirations de l'esprit humain : connaître le passé
et jouir de ses splendeurs. Aussi les monnaies sont-elles recherchées
par les hommes de goût et par les hommes de science ; les uns y
trouvent un délassement, une émotion artistique, les autres
y voient un objet d'étude sérieux et arrivent par un travail
pénétrant à des résultats incontestables.
Maurice Vallas était les deux à la fois.
Ses débuts furent ceux de presque tout amateur.
Il acheta sans idée arrêtée sa première monnaie
en 1971, c'était un bronze romain de l'empereur Constantin le Grand.
Puis il s'intéressa aux deniers de la République romaine
qu'il eut soin de choisir en très bon état de conservation.
Puis son choix se tourna vers les monnaies de l'empire romain. Mais bientôt
il fut ému par les beautés et les richesses des compositions
de l'art grec. En 1976 ses préférences se portèrent
tout d'abord sur l'histoire monétaire du Loir et Cher, son pays
natal puis en 1981 son attirance pour l'Orient le fit rechercher des monnaies
des Indes. Il a composé une des plus belle et plus complète
collection dans des deux domaines de prédilection. Sa dernière
acquisition en 2001 fut une monnaie d'argent des Carnutes.
Au cours de ses recherches, il lui arrivait fréquemment
de faire des remarques ou des découvertes intéressantes
; il s'empressait alors de les faire connaître en les publiant dans
des revues spécialisées.
" Maurice Vallas a été expert comptable
pendant plus de quatre décennies. Il a commencé à
rassembler des monnaies romaines dans les années 1950 puis s'est
intéressé au monde grec et tout particulièrement
à ses établissements d'outre-mer.
Les voyages nombreux, en Orient proche et lointain, lui ont permis d'approfondir
puis d'élargir ce domaine, notamment au sous-continent indien.
Enfin, Maurice Vallas était profondément attaché
à sa région natale, le Val de Loire. Ses publications d'histoire
locale et ses activités à la Société des Sciences
et Lettres du Loir et Cher en témoignent ainsi qu'une partie de
sa collection. Il a ainsi réuni des monnaies gauloises, mérovingiennes,
carolingiennes et féodales qui, pour la plupart ont été
frappées dans sa région d'origine. "
Ceux qui ont eu le bonheur d'être de ses amis,
se rappelleront de sa simplicité et de son admirable méticulosité
dans son rôle de collectionneur.
— L'ensemble de la collection qui vous ai livré aujourd'hui
se compose de trois rubriques :
— la Numismatique antique consacrée aux monnaies grecques
d'Asie et d'Afrique, aux monnaies romaines de la République et
de l'Empire romains ainsi qu'aux monnaies byzantines.
— la Numismatique orientale
— la Numismatique du Val de Loire des périodes gauloise, mérovingienne,
carolingienne et féodale.
La numismatique Antique de la Grèce proprement
dite. L'origine de la monnaie, dans le bassin méditerranéen
où est née la civilisation gréco-latine, ne remonte
pas au-delà du VIIe siècle avant notre ère. La monnaie
fut inventée probablement par les banquiers ou les commerçants
grecs de l'Asie Mineure sous l'hégémonie de Crésus,
roi de Lydie. Elle était frappée directement sur les pépites
d'or natif appelé électrum à cause de sa couleur
voisine de celle de l'ambre. La monnaie d'argent fut inaugurée
par les statères "à la tortue " d'Egine. On a
coutume d'utiliser pour le classement l'ordre géographique des
régions et des citées. La Collection Maurice Vallas nous
fait parcourir le bassin méditerranéen d'Ouest en Est en
décrivant un circuit complet : Péninsule ibérique,
Italie, Macédoine, Thrace, Grèce continentale, Péloponnèse,
Asie Mineure, Egypte , Cyrénaïque. Par contre, dans chaque
contrée ou dans chaque ville, l'ordre chronologique permet de suivre
le développement artistique de l'art monétaire, les évènements
historiques qu'elles commémorent ou de suivre la succession des
princes, des rois ou des magistrats des citées.
La Collection Maurice Vallas comporte un choix important
de deniers d'argent de la République Romaine, du Haut Empire et
du Bas-Empire romains. Suivent quelques monnaies byzantines frappées
à Constantinople. Pour subvenir aux besoins des armées,
les généraux romains furent amenés à battre
monnaies dans quelques villes, notamment à Capoue. Le monnayage
proprement romain débute en 268 avant J.-C., époque où
un atelier monétaire fut installé sur le mont Capitolin,
près du temple de Juno Moneta. Les premières émissions
furent des deniers équivalent à 10 as, le quinaire qui en
valait 5 et le sesterce, deux et demi. Le monnayage d'or commence beaucoup
plus tard, en 87 avant J.-C. Toutes ces monnaies portent des types de
divinités, des allégories, la tête casquée
de Rome, les Dioscures, le bige de la Victoire, Diane... Dans cette série
on remarquera le denier d'Herennius représentant Amphinomus emportant
son père sur ses épaules devant l'éruption du Vésuve
; le denier d'Hostilia montrant la Diane d'Ephèse ; le denier de
Fonteia pour la chèvre d'Amalthée ; une superbe représentation
d'un des douze travaux d'Hercule au revers d'un denier de Poblicia . Le
portrait qui a fait son apparition sur les monnaies avec Jules César
en (50 avant J.-C.) devient incontournable. Tous les empereurs qui lui
ont succédé nous ont laissé une suite iconographique
incomparable. Les revers des deniers et des aurei nous livrent des allégories,
des allusions aux anciennes légendes de Rome et aux évènements
importants de chaque règne avec une richesse d'interprétation
qui font de la monnaie une source inépuisable d'enseignements.
Le monnayage romain se continue à Byzance. L'identité des
types est constante durant tout le Ve siècle : buste casqué
et armé de face. En 491, Anastase met en place une importante réforme
monétaire en créant un type proprement byzantin qui se perpétuera
jusqu'à la chute de Constantinople.
La Numismatique Orientale offre des suites très variées
révélées par la collection Maurice Vallas. On y voit
dans les débuts, l'influence grecque dominante et peu à
peu, celle-ci est chassée par les goûts et les écritures
asiatiques.
On distingue deux catégories : le monnayage qui continue celui
des grecs dans les pays soumis et le monnayage des pays voisins dont l'origine
est indépendante.
Les HIMYARITES On donne ce nom aux habitants de l'Arabie heureuse ou Yémen,
leur monnayage s'étend du IV e siècle avant J.-C. à
l'an 120 de notre ère et imite les monnaies étrangères
et notamment les monnaies athéniennes.
MESOPOTAMIE Carrhae a des monnaies depuis Marc-Aurèle. Edesse était
la capitale du royaume d'Orsrhoène fondé en 132 avant J.-C.
; ses rois depuis 166 après J.-C. était sous protectorat
romain et sur les monnaies leur types sont associés à ceux
des empereurs.
ROYAUME DES PARTHES Le monnayage des Parthes s'étend sur une période
de plus de 350 ans, depuis le règne de Mithridate Ier (171-138)
jusqu'à Artaban V et Artavasde (244-228). Les drachmes à
l'effigie du roi imberbe coiffé d'un bonnet pointu à oreillettes
avec au revers un archer sont appelées " monnaies sacerdotales
".
PERSIDES Les dynastes de Persépolis, après Alexandre le
Grand, émirent de lourdes monnaies d'argent à légendes
araméennes et l'effigie du roi coiffé du bachlik. Au revers,
l'image du temple ou de l'autel devant lequel le monarque faisait ses
dévotions.
EYMAIDE OU SUSIANE Le premier satrape de ce pays est Kamnaskirès
(vers 163 avant J.-C.)
ROIS DE CHARACENE La capitale de ce royaume était Charax au fond
du golfe persique. Une dynastie royale qui exerça le pouvoir de
124 avant J.-C. à 115 de notre ère. Le premier en date fut
Hyspoasines...
SASSANIDES Les sassanides régnèrent en Perse depuis la défaite
des Parthes, qui furent chassés du pays en 228 de notre ère
jusqu'à la conquête de la Perse par les Arabes en 651. Les
plus célèbres furent Sapor Ier qui fit prisonnier l'empereur
romain Valérien puis Chosroes . Les drachmes représentent
les roi parfois accompagné de leur épouse et de leur fils
à l'image de Varahan II, de la reine et de son fils. Les légendes
sont inscrites en pehlvi et les revers représentent le pyrée
ou autel du feu entre deux prêtres " mobeds ". Les monnaies
deviennent de plus en plus minces et la technique monétaire se
rapproche de celle de la période byzantine.
ROIS DE BACTRIANE ET DE L'INDE Les monarques les plus importants à
signaler sont : Sophytes qui régna de 316 à 306 avant J.-C.
au nord du Pendjab ; Diodote (250 avant J.-C.) à qui l'on doit
de beaux statères d'or ; Démétrius, coiffé
de la peau d'éléphant ; Euthydème II ; Antimaque
; Eucratide...
ROIS INDO-SCYTHES OU KOUCHANS, derniers souverains ayant employé
la langue grecque jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Les
monnaies de ces rois : Kadphises, Kaniska, Vasudeva portent l'effigie
royale. Les divinités et les attributs du culte ont un rôle
très important dans la figuration ornant ces monnaies.
ROIS DE NUMIDIE Jusqu'à la victoire de César à Thapsus
et la mort de Juba Ier en 46 avant J.-C., les rois de Numidie ont frappé
des monnaies à leur effigie.
La Numismatique du Val de Loire rassemble des monnaies
gauloises en argent et en bronze, des monnaies mérovingiennes en
or, des monnaies carolingiennes et féodales sous la forme de deniers
d'argent.
Les monnaies gauloises de la Collection Maurice Vallas
sont essentiellement originaires des CARNUTES (région de Chartres),
sa région natale.
On compte cinq tiers de sous mérovingiens et un denier. Ces monnaies
ont été frappées en dehors de l'action du roi. Certaines
villes détenaient le privilège de battre monnaies. Elles
étaient généralement fabriquées par des orfèvres.
Les deniers carolingiens au monogramme de Charles le Chauve, Louis III,
Eudes, Charlemagne, Raoul qui figurent dans la collection sont de Blois,
Bourges, Chartres, Châteaudun, Orléans, Tours et Vendôme.
Ces monogrammes des monarques carolingiens se modifient en châtel
tournois avant de devenir pièce royale.
A la fin de la dynastie carolingienne, les comtes chargés
de gérer les ateliers monétaires avaient usurpé la
propriété de ces ateliers et s'attribuèrent les bénéfices
de la monnaie. C'est ainsi qu'aux Xe , XIe, XIIe siècles, les comtes,
barons, ducs, frappèrent des monnaies destinées à
alimenter le commerce des foires locales. Dans la région qui nous
préoccupe, les deniers carolingiens ont été transformés
au point de donner naissance à de nouvelles figures du type dit
chinonais et bléso-chartrains. La silhouette de cette effigie devient
purement géométrique telle qu'on les voit dans les armes
de la ville de Chartres. Cette évolution de l'effigie d'un modernisme
remarquable est particulièrement bien illustrée dans la
collection Maurice Vallas
F.B.-V.